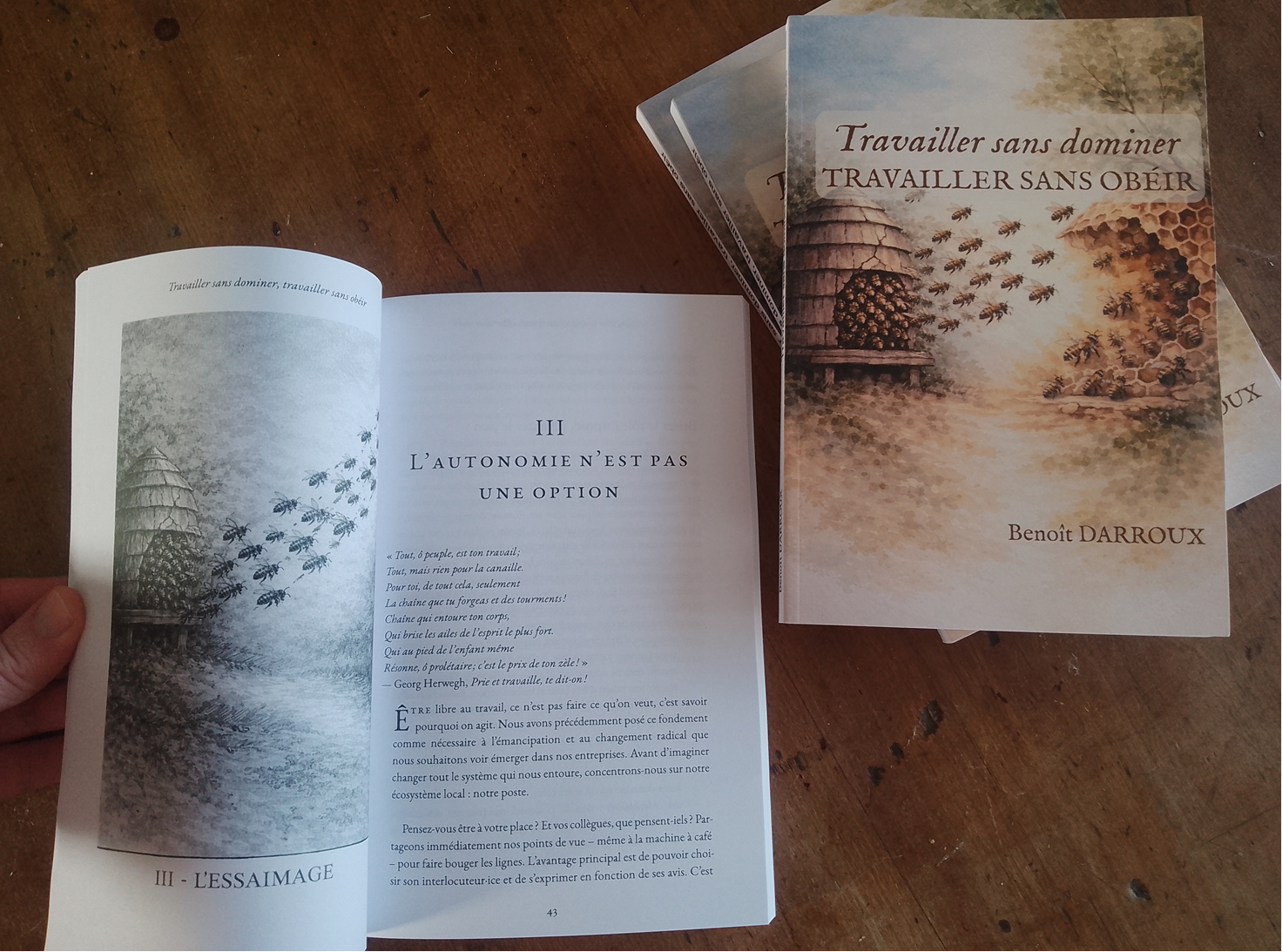Dans un monde où le travail rime trop souvent avec acharnement et soumission, il est temps de repenser nos manières de collaborer. Cette phrase pourrait se lire comme une dénonciation — elle est d’abord une proposition. À partir d’expérimentations menées auprès d’équipes et d’organisations, ce livre se veut un manifeste pragmatique : il n’agit pas comme une utopie lointaine, mais comme un manuel de transformation à portée d’équipe. Comme je l’explique dans mon précédent ouvrage, l’autonomie et la sécurité psychologique ne sont pas des idéaux abstraits, mais des leviers concrets pour transformer nos organisations.
Le constat actuel
Le constat est simple et répétitif : beaucoup d’organisations proclament l’autonomie et l’empowerment (sic), sans en offrir les conditions réelles. On rencontre des cellules dites « autonomes » où les décisions cruciales restent, en coulisse, centralisées ; des professionnel·les compétent·es qui ne comprennent plus à quoi sert leur travail ; des réunions où l’on applaudit l’expression d’idées nouvelles mais où, dans les faits, rien ne change. Ce décalage crée du désengagement, des stratégies d’évitement et une autocensure sournoise. Au cœur de cette dynamique se trouve souvent une sécurité psychologique fragile — c’est-à-dire l’absence réelle d’un espace sûr où iel peut exprimer une crainte, poser une question ou avouer une erreur sans craindre la réprimande ou l’humiliation. C’est la définition même d’Amy Edmondson que nous retenons ici : « la croyance que chaque personne peut partager une crainte, un doute, une question, une erreur, sans craindre de reproche, de réprimande ou d’humiliation de la part de son équipe. »
Un témoignage
Raconter des transformations passe par des exemples. Dans un grand groupe industriel que nous avons accompagné en 2024–2025, une équipe a accepté d’expérimenter un cadre de collaboration radicalement co-construit. Iels ont défini ensemble les règles du quotidien, la façon de partager les tâches, et surtout les modalités de prise de décision en autonomie. Au début, la peur était visible : certains·nes craignaient de prendre des initiatives sans l’« aval » habituel. Progressivement, en donnant des permissions claires et en protégeant les premiers essais ratés des conséquences disciplinaires, l’équipe a trouvé son rythme : participation accrue, propositions opérationnelles, et un vrai sentiment de responsabilité partagée. La leçon ? Un encadrement permissif mais structuré, combiné à la sécurité psychologique, active l’initiative plutôt qu’il ne l’étouffe.
Vos valeurs sont importantes
Qu’est-ce que les valeurs libertaires apportent concrètement au travail ? Plutôt qu’un dogme, il faut les lire comme des principes pratiques : autonomie dans la prise de décision, absence de coercition, responsabilité partagée, équité dans la répartition des tâches, et liberté d’apprentissage. Ces principes ne signifient pas l’anarchie du laisser-faire ; ils réclament au contraire une discipline partagée : règles claires, rétroactions régulières, et mécanismes de résolution des conflits non punitifs. L’ancrage des valeurs libertaires dans l’organisation du travail se traduit donc par des processus — comités rotatifs, rôles clairs mais flexibles, revues d’expérimentation — qui donnent à iels les moyens d’agir et d’apprendre en sécurité.
Pourquoi cela marche ? Parce que la sécurité psychologique et l’autonomie forment un couple vertueux. Quand une personne sait que dire une difficulté ne lui vaudra pas d’humiliation, elle osera proposer, corriger et améliorer. Quand les équipes sont dotées d’un pouvoir réel de décision, elles apprennent plus vite, ajustent leurs pratiques et prennent la responsabilité de leurs résultats. Le cercle s’auto-alimente : les initiatives réussies renforcent la confiance, les erreurs partagées nourrissent l’apprentissage collectif, et la culture évolue. Ce modèle s’oppose aux logiques de contrôle centralisé où la peur de l’échec génère procédures, reportings, et immobilisme.
Passer de la théorie à la pratique requiert des gestes précis. Voici quelques repères issus de nos accompagnements et des lectures-boussoles (Edmondson, Laloux, Proudhon, Kropotkine) : d’abord, mesurer la sécurité psychologique réelle par l’observation et des entretiens anonymes ; ensuite, co-construire des « permissions expérimentales » — petites autorisations données pour tester des idées sans sanction ; enfin, instituer des rituels de retour d’expérience où l’erreur devient matériau d’apprentissage plutôt que preuve de faute. Ces étapes demandent du courage managérial : renoncer à la toute-puissance décisionnelle pour la transformer en responsabilité partagée. Mais l’effort investit est rapidement retourné sous la forme d’engagement, d’innovation et de qualité du travail.
N’est-ce pas encore une utopie ?
Il y a des objections légitimes : l’autonomie ne risque-t-elle pas d’engendrer du désordre ? Les réponses sont pratiques. L’autonomie contrôlée par des principes d’équité et de transparence réduit la dispersion : quand les règles de partage des tâches sont co-signées, les tensions structurelles se voient et se traitent. La prise de décision en autonomie ne signifie pas l’absence d’arbitrage : elle signifie que l’arbitrage se fait au bon niveau, c’est-à-dire au plus proche de l’action, et avec des mécanismes de recours si besoin. Dans les équipes que nous avons aidées, l’équité dans le partage des tâches a été un point clef : répartir les responsabilités selon la charge réelle et les compétences évite la sur-exploitation de certains·es et renforce la confiance.
Il faut aussi parler de pédagogie : accompagner ce mouvement demande des temps d’apprentissage, de facilitation et de médiation. Les coach·es d’équipe, les facilitateurs·trices et les RH ont un rôle central pour orchestrer les premiers pas. Une posture essentielle ici est la transparence méthodologique : expliquer pourquoi l’on change, comment seront évalués les essais et comment seront traitées les erreurs. L’invitation n’est pas à déléguer le chaos mais à créer des espaces structurés où la créativité peut s’exprimer sans risque d’humiliation. La Communication Nonviolente (Rosenberg) et la pédagogie de l’écoute (Krishnamurti) sont des ressources utiles pour installer ces nouveaux rapports.
La narration de ce livre navigue entre l’analyse et le récit pour rendre visibles les tensions et les possibilités. On y trouvera des portraits anonymisés, des scènes de réunions transformatrices, des impasses et les bifurcations qui ont permis de les dépasser. Ces récits servent un objectif : démontrer que la transformation est accessible, progressive et reliée à des pratiques très concrètes. Ils montrent aussi la fragilité des premières étapes — la nécessité d’un soutien institutionnel minimal pour que l’autonomie ne reste pas un mot creux.
Osons changer !
La transition vers des organisations plus humaines ne se fait pas sans politique. L’idée libertaire appliquée en entreprise n’est pas une idéologie extérieure mais une boussole pour réinventer les règles du jeu. Elle nous demande d’interroger la justice au travail : qui bénéficie des ressources ? comment se partagent les prises de parole ? comment garantir l’équité dans la charge émotionnelle et cognitive ? Repenser ces questions amène à des dispositifs concrets : évaluation collective des charges, budget d’apprentissage individualisé, et régimes de responsabilité proportionnés. Ces dispositifs réduisent les asymétries de pouvoir et favorisent une participation plus large.
Pour conclure, choisir de redéfinir les règles du travail est un pari sur la responsabilité collective. Si nous voulons des équipes capables d’affronter la complexité, nous devons leur donner des permissions pour apprendre, des protections pour échouer, et des structures pour s’organiser. Si cette lecture résonne en vous et que vous souhaitez aller plus loin, commencez par une petite expérimentation : offrez à une équipe la possibilité de décider d’un projet pilote, protégez-la des conséquences en cas d’échec, et observez ce qui se passe. Les premiers signes de transformation — prise d’initiative, échanges plus francs, amélioration de la qualité — arriveront plus vite que vous ne le pensez.
Enfin, si vous souhaitez prolonger cette exploration, vous trouverez dans ce livre des outils pratiques, des récits de terrain et une proposition de manifeste pour redéfinir nos modèles organisationnels. Si votre objectif est de passer de l’envie à l’action, ce manifeste donne des marches concrètes.
La suite est ici : https://www.coollibri.com/bibliotheque-en-ligne/benoit-darroux/travailler-sans-dominer-travailler-sans-obeir_1425458